 |
44(2)
Le présent volume présente trois articles : l’un du français Elann Lesnes, les deux autres provenant d’Amérique du Nord, à savoir celui de Virginie Houle et Isabelle Atkins du Québec et celui de Bárbara M. Brizuela, Mónica Alvarado et Susanne Strachota des États-Unis et du Mexique.
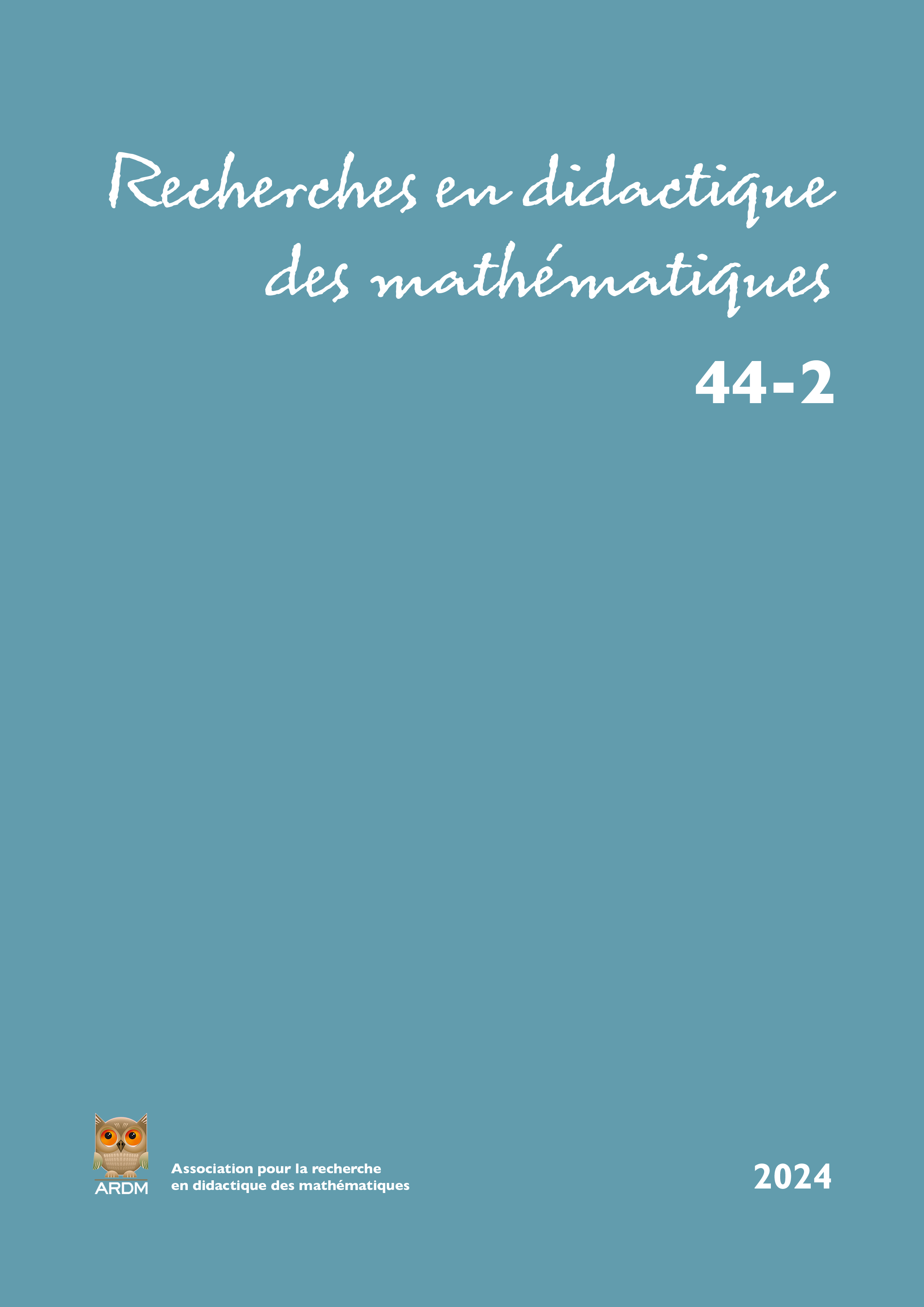
1. Vers une entrée dans la géométrie théorique au cycle 4 : construction d'une référence épistémologique et modélisation didactique dans un EIAH
Elann Lesnes.Au collège, les élèves (11-15 ans) ont des difficultés à entrer dans la géométrie théorique attendue dans les programmes scolaires. Nous étudions ces difficultés à la transition du cycle 3 (grades 4 à 6) au cycle 4 (grades 7 à 9) et nous faisons l’hypothèse que la résolution de tâches de construction vérifiant certaines conditions favorise l’entrée dans le raisonnement déductif. Ce travail est implémenté dans un EIAH dans le cadre du projet MindMath. Nous concevons donc des modèles didactiques implémentables du savoir, de l’activité géométrique de l’élève, des tâches et des parcours d’apprentissage.
2. Incidences des caractéristiques de situations à caractère ludique sur l’engagement et l’apprentissage d’élèves suivis en orthopédagogie
Virginie Houle ; Isabelle Atkins.Ce texte porte sur l’analyse de trois situations mathématiques à caractère ludique investissant la multiplication et la numération décimale de position. Ces situations ont été expérimentées au Québec par une orthopédagogue travaillant auprès de quatre élèves de 9-10 ans identifiées en difficulté par leur enseignante. Prenant appui sur les positions de joueur, d’actant, d’apprenant et d’élève de Brousseau (2002) ainsi que sur le concept de contrat didactique et ludique de Pelay (2011), nous nous intéressons à la façon dont s’articulent les enjeux didactiques et ludiques au sein des interactions en prenant en compte les caractéristiques propres à chaque situation. Notre étude permet de préciser l’incidence, sur l’engagement et l’apprentissage, de deux caractéristiques des situations, soit la nature de la relation entre les élèves, qui peut être compétitive ou coopérative, et le contrôle exercé sur le gain, qui peut reposer sur le hasard ou sur les décisions des élèves.
3. Utilisation des tableaux par les enfants du début de l’école élémentaire qui résolvent les problèmes additifs de Vergnaud
Bárbara Brizuela ; Mónica Alvarado ; Susanne Strachota.Cet article décrit les réponses de jeunes enfants du primaire aux problèmes additifs qu’ils résolvent à l’aide de représentations papier-crayon, en particulier avec l’utilisation d’un tableau. Nous explorons la question de recherche suivante : de quelle manière les tableaux influencent-ils la précision et la capacité des jeunes élèves (de la 1re à la 3e année d’école élémentaire, âgés de 6 à 8 ans) à résoudre des problèmes additifs, notamment en identifiant les inconnues et les composantes des problèmes ? Des enfants d’une école publique située dans une banlieue diversifiée du nord-est des États-Unis ont été interrogés individuellement. Chaque enfant s’est vu présenter six problèmes additifs tirés des travaux de Vergnaud (1982). Nous avons conçu trois contextes de représentation (avec une feuille de papier vierge, avec un tableau sans étiquette ou avec un tableau étiqueté), auxquels les enfants ont été assignés au hasard. Nous obtenons trois résultats. Premièrement, nos données soulignent que, ce que les enfants peuvent faire dépend du contexte du problème et des outils dont ils disposent. Deuxièmement, nos données illustrent comment certaines représentations aident les enfants à résoudre les problèmes de type « composition de deux transformations », mais pas nécessairement les problèmes de « transformation de mesures ». De plus, les enfants sont capables de répondre avec plus de succès à certains […]